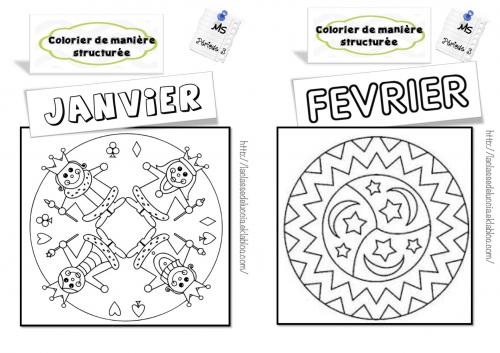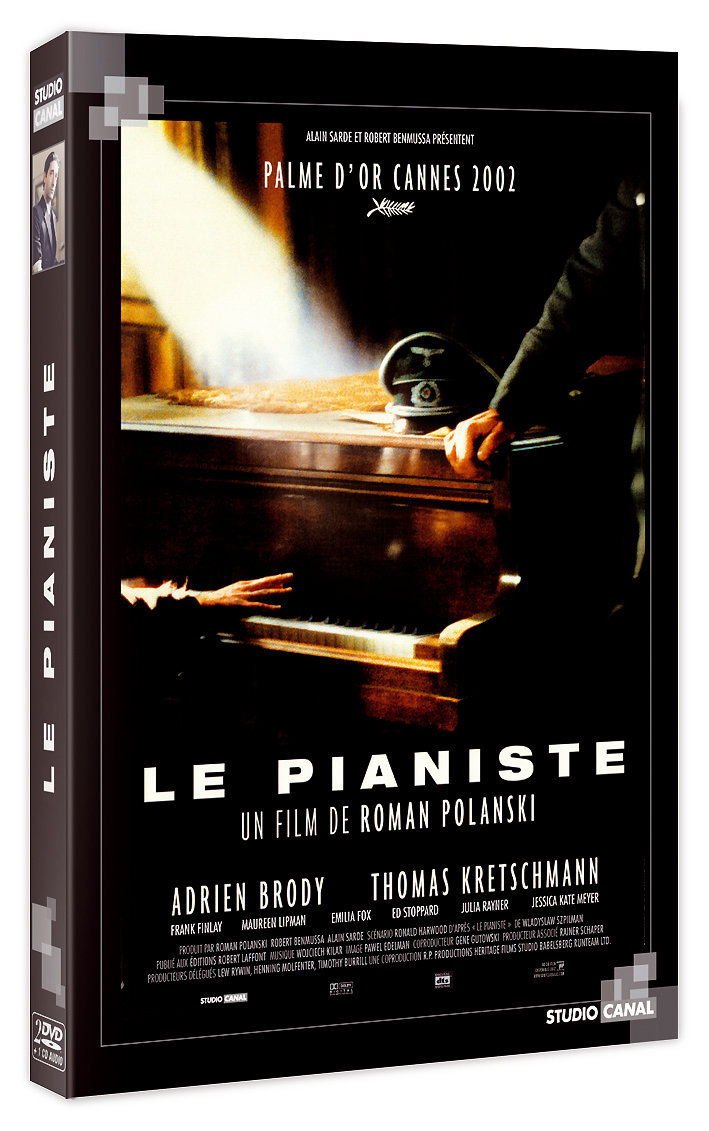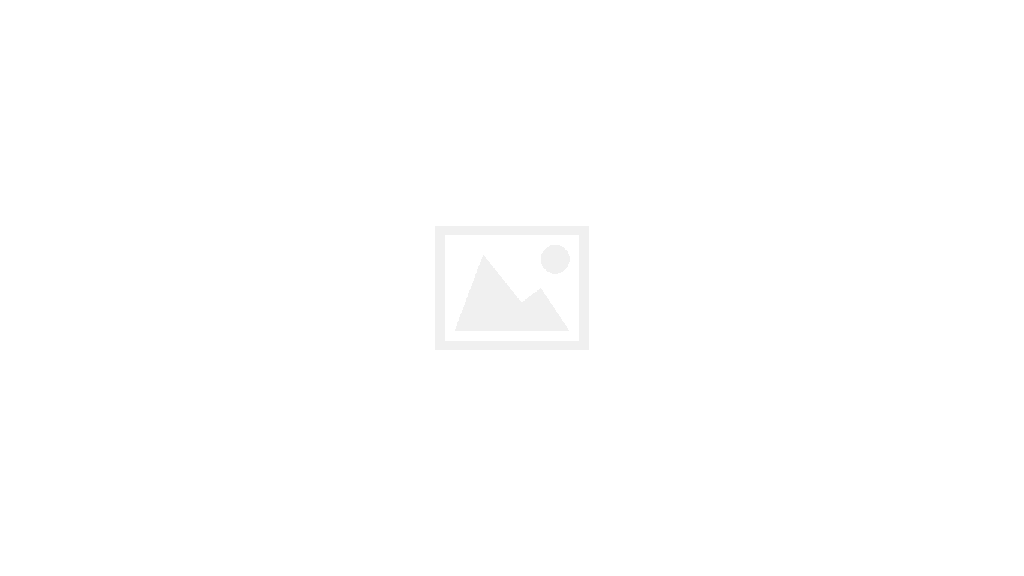En janvier prochain, Inflexions publiera un numéro intitulé « Violence totale ». La philosophe Monique Castillo y signe « Justifier la violence extrême ? » : « Comment comprendre que soient tenues pour légitimes des pratiques extrêmes et déshumanisantes de la destruction d’autrui ? Une illimitation de la haine quand elle est érigée en droit ? La conversion du révolutionnaire en un compassionnalisme complaisant ? Ou l’incapacité de retrouver la force de s’opposer à la violence ? ».
Voici, en avant-première, cet article.
Justifier la violence extrême ?
Monique Castillo
La férocité de certaines violences provoque une condamnation spontanée : elles sont « barbares », « monstrueuses » ou « folles », autant de qualifications qui ne font que traduire les réactions du spectateur, c’est-à-dire, en vérité, son sentiment d’impuissance devant l’inexplicable (« folie »), l’intolérable (« barbarie »), l’injustifiable (« monstruosité »). Au plus profond, l’horreur éprouvée résulte du fait, indicible, que les auteurs de telles violences puissent précisément les revendiquer et par là-même les justifier ; le mal spécifique de la violence pourrait bien être celui-là : une déshumanisation légitimée des pratiques extrêmes de la destruction. En faisant de la violence un moyen ultime et absolu, un instrument de domination définitive et totale, le violent incarne la justification de l’injustifiable. Ce qui suscite le questionnement : qu’est-ce qui cause ou favorise cette légitimation de l’inacceptable ?
L’illimitation du recours à la violence
René Girard fournit une réponse à ce type d’interrogation quand il associe sa théorie de la violence mimétique au principe d’action réciproque qu’il découvre chez Clausewitz : « Chez les animaux, il y a la prédation, il y a sans doute la rivalité génétique pour les femelles. Mais avec les hommes, si personne n’a jamais le sentiment d’agresser, c’est que tout est toujours dans la réciprocité. Et la moindre petite différence, dans un sens ou dans un autre, peut provoquer une montée aux extrêmes. L’agresseur a toujours déjà été agressé . »
Dire que l’agresseur se considère toujours comme d’abord agressé, c’est constater que la violence s’auto-justifie et qu’elle se présente initialement comme une riposte toujours légitimée par avance par une agression : « C’est parce qu’il “répond” aux États-Unis que Ben Laden organise le 11 septembre . » Se donner le droit à la revanche entretient la réciprocité, c’est-à-dire la logique du duel à mort, la pratique sans fin de la violence et de la contre-violence. Se considérer comme victime allume la passion du ressentiment qui use de la surenchère. Dès lors que la rivalité mimétique (ravir le pouvoir à son adversaire pour l’exercer à son tour) use de la concurrence victimaire, qu’elle se planétarise et que la religion, loin de calmer le jeu, l’envenime, la violence met en branle un processus capable de conduire le monde à l’apocalypse.
En termes moins dramatiques, comprenons que la guerre échappe à la politique, qu’elle s’entretient elle-même (la privatisation, la multiplication et la banalisation des conflits asymétriques montrent que la faiblesse finit par se prendre pour un droit d’utiliser tous les moyens), que la politique court derrière la violence qui aura toujours une longueur d’avance . L’analyse de Girard explique ainsi à sa façon l’efficacité à la fois physique et mentale de la violence terroriste, qui administre, par une exhibition systématique de la violence, la preuve que celle-ci ne cessera de revenir, qu’elle n’est plus de l’ordre de l’action raisonnée, mais d’un processus de conquête du pouvoir par le moyen exclusif de la destruction totale du pouvoir de l’adversaire.
L’autolégitimation victimaire conduit à l’extrémisme quand l’asymétrie agit comme un facteur moral d’illimitation du « droit » d’anéantir. Hannah Arendt a montré comment la victimisation du faible, exaltée en idéologie révolutionnaire, peut conduire à l’exacerbation de la violence en enclenchant la dynamique sans fin de la vengeance. « Les hommes de la Révolution entreprirent d’émanciper le peuple non pas en tant que futurs citoyens, mais en tant que malheureux . » Des « enragés » de la Révolution française aux « damnés de la terre » de la Révolution soviétique s’accomplit l’histoire d’une même dérive : la révolution a changé de route et abandonné les motifs de la liberté pour lui préférer ceux de la pauvreté, donnant ainsi une postérité terrifiante à la conviction que « les malheureux sont les puissances de la terre » .
Le ressort initial de ce changement fut, explique Arendt, la pitié. Non pas la compassion en tant que sentiment de notre commune humanité souffrante, mais la pitié idéologisée et pervertie, celle qui érige la faiblesse en « bonté » et le malheur en « vertu », en une innocence si absolue, originaire et indiscutable qu’elle a pu devenir une arme physique et morale (le pouvoir des masses) dressée contre l’« hypocrisie » des riches, dans un combat sans fin puisque « la chasse aux hypocrites est, par nature, illimitée » . La pauvreté devient ainsi l’instrument d’une politique de destruction qui exalte la valeur morale du malheur au moment où elle le transforme en un réservoir intarissable de violence indéfiniment exploitable.
De nos jours, la médiatisation apporte à l’analyse une dimension nouvelle : l’élément symbolique de la violence vient alimenter la montée aux extrêmes. Alors que la violence animale détruit la vie pour consommer une proie, la violence humaine cherche à détruire aussi les raisons de la vie, à abolir ce qui donne un sens à celle-ci. Par suite, quand la volonté d’anéantir ne porte pas uniquement sur l’existence physique de l’adversaire, mais sur ce qu’il représente, ce qu’il symbolise, sur ses mœurs, ses valeurs, ses raisons d’exister, s’engage une guerre des représentations et des images qui, la médiatisation en multipliant spectaculairement l’efficacité émotionnelle, conduit à des surenchères insupportables : exhibition sans retenue des carnages provoqués, mise en scène de supplices devant les caméras, exultation publique des auteurs d’atrocités… Autant de moyens de provoquer la panique en rendant la violence omniprésente, à la fois intolérable et imprévisible. La médiatisation a pour effet de coaguler les peurs subjectives dans une même impression de danger collectif et d’atteindre cet adversaire collectif dans sa propre conscience de soi, en mettant en échec ses moyens de comprendre autant que son aptitude à tolérer.
Quand un « droit » auto-justifié à la violence porte sur des symboles, il s’ouvre une carrière illimitée, puisque détruire physiquement une abstraction est une impossibilité dont la tentative inaugure un processus sans terme. Détruire l’Occident, la modernité, l’incroyance ou la démocratie… c’est vouloir détruire une représentation du « mal », comme si le mal « en soi » était une réalité physique, alors qu’on n’anéantira jamais que les représentants dont on choisit de faire des symboles exemplaires. Cette malédiction de la violence déchaînée contre des symboles ne touche pas seulement la guerre ou le terrorisme, elle sape la vie des banlieues et décourage le courage d’enseigner. On sait que, dans certains établissements, on humilie ou persécute ceux qui aiment l’école…
La violence culturalisée
Pour un adepte de la non-violence, « ce qui, en définitive, fonde la culture de la violence, ce n’est pas la violence, mais la justification de la violence. […] La culture confectionne un habillage qui a pour but, non pas de désigner la violence, mais de la déguiser. Cet habillage veut occulter la violence de la violence en la légitimant comme un droit de l’homme et en l’honorant comme la vertu de l’homme fort » . Pour rendre compte de cette complicité de la culture avec la violence, il faut tenter de comprendre l’accueil, le soutien ou la complicité que la violence peut paradoxalement recevoir de ceux-là mêmes qui la condamnent ou qui la subissent.
L’usage de la violence trouve facilement, il est vrai, des justifications culturelles : il suffit de la juger « naturelle », de la regarder comme « inévitable » ou « nécessaire », de l’encourager comme un droit à la riposte… Et il faut bien reconnaître que l’éducation, la société et l’opinion donnent une place culturellement « naturelle » à la violence. Si bien qu’elle jouit, de façon générale, d’une légitimité qui fait d’elle une sorte de droit subjectif aussi bien que social, sinon un signe de courage et d’honneur. Cette culturalité de la violence fait partie de l’éducation. Un père ou une mère acceptent mal de voir leur enfant battu par d’autres enfants sans riposter : il faut lui enseigner que l’affrontement est une situation dans laquelle la violence est légitime, ne serait-ce que momentanément, comme une exception nécessaire qu’il faut savoir se réserver.
La violence est tout particulièrement culturalisée dans les scénarios porteurs de symbolique justicière. Dans le western, par exemple, l’autorité paternelle aussi bien que la juste guerre présentent le « bon côté » de la violence : elle répare, elle venge, elle rend justice. Toute culture fait cette part à la violence au nom de l’honneur, de la survie, au nom même de la valeur de la vie. D’où cet étonnement : comment expliquer qu’une légitimation morale et politique de la violence puisse émaner de ceux qui en sont les premières victimes ?
Que les sacrifices humains soient des faits de culture, institutionnalisés par de grandes civilisations prémodernes, a été interprété comme une mystique du sang versé. Cette débauche de violence ne ferait qu’anticiper, explique Joseph de Maistre, une vérité religieuse universelle qui veut la purification par le sang. L’effusion de sang et l’horreur des sacrifices seraient ainsi pourvues d’un sens précis, celui du salut ou de la communion : « Comment ne pas croire que le paganisme n’a pu se tromper sur une idée aussi universelle et aussi fondamentale que celle des sacrifices, c’est-à-dire de la rédemption par le sang ? »
On comprend, à un premier degré, que de tels excès de violence dépassent à ce point les limites ordinaires de l’intelligence qu’elle en vient à les regarder comme surnaturels ou divins, comme si leur extrême inhumanité contribuait à leur donner une paradoxale transcendance surhumaine. On craint, à un second degré, que cette fascination funèbre ne soit en train de renaître dans la rage de mondialiser le spectacle de sacrifices d’otages à la manière d’une nouvelle mystique du sang versé. À moins qu’il ne s’agisse d’une adhésion conformiste à une institutionnalisation de la violence qui suffit pour la faire passer pour juste : dans ce cas, la violence vérifie un ordre du monde qui dépasse la mesure humaine.
Une interprétation sociologique du phénomène met en parallèle la résignation intime à la violence nazie et celle des populations marquées par la violence des fanatiques islamistes : un ordre du monde se vérifie, qui fait le partage entre bonnes et mauvaises races, dans un cas, entre fidèles et infidèles, dans l’autre ; à défaut d’en comprendre la raison ultime, la population est invitée à s’installer dans un ordre du monde que la violence structure et justifie.
Chez les Modernes, c’est plutôt une idéologie de la violence réparatrice qui contribue à justifier un usage de la violence extrême alors même que l’on prétend travailler à l’avènement d’un monde qui supprime la violence du pouvoir. La préface de Jean-Paul Sartre aux Damnés de la terre de Franz Fanon en fournit une illustration connue et instructive. Il y légitime la violence des colonisés jusqu’à la provoquer et l’exalter : « Abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre . » Il est facile de démonter le raisonnement : la colonisation doit être condamnée, c’est là une revendication que chacun comprend et qu’une majorité légitime ; mais que cette revendication serve à légitimer un droit absolu au meurtre aveugle du premier venu fait problème ; un conflit éclate inévitablement entre l’efficacité de la violence (physiquement incontestable) et la moralité de sa justification (éthiquement infondable).
C’est pour des raisons politiques que Sartre en appelle à la violence extrême (au sens qu’il ne peut y avoir de liberté sans la mort de l’autre) en identifiant hâtivement la terreur à une « juste guerre ». Mais quelle réponse donner à la terreur qui se légitime de manière moins politique que culturelle et se donne ouvertement des mobiles communautaires et religieux au point de dresser une civilisation contre une autre ?
Pour nombre d’observateurs, le nazisme a initié une guerre raciale au nom d’une culturalité particulière (la germanité) contre l’universalisme de la civilisation démocratique et libérale, usant de la violence totale (génocidaire) pour conquérir un pouvoir total. Un tel extrémisme a été résolument condamné de manière quasi unanime par les démocraties comme une catastrophe politique et humaine interne à la civilisation occidentale.
Mais la situation du début du XXIe siècle diffère sensiblement en ce qu’elle écartèle la démocratie entre sa force et ses valeurs, entre son désir de paix et son refus du rejet de l’Autre (autre culture, autre communauté, autre religion). Face aux attaques terroristes s’installe ainsi une sorte de principe de précaution moral qui condamne en même temps l’agresseur et la tentation de contre-violence de l’agressé pour éviter l’amalgame entre violence fondamentaliste et religion. Toutefois, outre que la neutralité en la matière risque de passer pour indifférence ou complaisance envers des actions manifestement criminelles, il semble que cette timide délégitimation de la violence totale échoue dans un immobilisme qui favorise paradoxalement l’imprévisibilité et l’omniprésence de la violence sporadique. « Anorexie stratégique » ou « vacuité spirituelle de l’Europe» ?
Le philosophe américain Mikaël Walzer met en cause la « culture de gauche » pour le soutien paradoxal (évidemment non délibéré) qu’elle apporte à la cause terroriste par une sorte d’inertie idéologique qui perpétue la compassion victimaliste de son révolutionnarisme. Il cite le philosophe slovène Slavoj Zizek, pour qui le radicalisme islamique exprime « la rage des victimes de la mondialisation » (les Français se souviennent, quant à eux, du soutien ouvertement apporté par le philosophe Jean Baudrillard aux attentats du 11 septembre 2001). C’est ainsi qu’une certaine inertie idéologique continuerait d’identifier la pauvreté à un réservoir de violence légitimée pour toujours et d’en faire un facteur de « progressisme » social mondialisé. Toutefois, Walzer n’en reste pas à une simple mise en cause de tels tropismes intellectuels, et il envisage pour l’avenir une reconversion et une refondation de « la gauche » par elle-même.
Si la question est vitale pour les Européens, c’est qu’ils comprennent que la barbarie de la violence terroriste risque de les entraîner dans la barbarie d’une culture totalement réduite à la peur de la violence. En l’absence d’unité politique, l’Europe paraît se donner une unité morale qui se borne à mettre en pratique un pacifisme simplement abstrait et magique. La croyance en un pluralisme unificateur merveilleusement capable de désarmer les adversaires de la paix ne trompe pourtant personne, et chacun sait qu’elle traduit un moralisme de confort qui assure mentalement la paix d’une opinion majoritaire. C’est ainsi que le combat contre les « violents » se réduit à une affaire de mots, à des querelles de formules et à des invectives sur des images qui installent la conscience médiatique de chaque jour dans un attentisme devenu le style de son impuissance.
La force contre la violence
La confusion des mots et des images peut être poétique (« la terre est bleue comme une orange »), comme elle peut être politique quand un « signifiant vide » crée par son abstraction une illusion de consensus ; ainsi la justice, le bien, le pluralisme… sont des objectifs communs à des individus et à des groupes qui en ont pourtant des conceptions rivales, mais leur généralité informelle et leur échéance lointaine assurent momentanément une certaine tranquillité sociale. Toutefois, si une rhétorique des images peut contribuer à unir une communauté, elle peut aussi opérer comme un refus du réel : le consensus dit « moralement correct » vise assurément la paix sociale, mais c’est un consensus vide, qui évite d’affronter les violences et les contradictions de la réalité telle qu’elle est.
Dans ce registre, le choix d’identifier toute force à une violence et de la condamner comme telle jouit d’une assez grande efficacité consensuelle, la violence (parentale, étatique, symbolique, économique, judiciaire…) devenant une catégorie assez extensive pour abriter toutes les condamnations d’abus de pouvoir. Mais le procédé a son revers car sa systématicité a pour effet de « manichéiser » et de sacraliser le couple violence/faiblesse en donnant à la faiblesse, identifiée à l’innocence et à l’impuissance, une autorité morale et un prestige social en quête de position dominante.
Or cette manière de renoncer à la lutte fait le lit des sophismes sur lesquels prospère la violence. Parmi eux, celui qui identifie la violence à la vie est doublement pernicieux, puisque la violence ne régénère pas la vie mais la détruit et parce que la confusion fait oublier que c’est la lutte, et non la violence, qui est nécessaire à la vitalité de la vie. Si l’on veut dire qu’il est impossible d’éliminer la violence de la vie, on ne risque pas de se tromper car il est des situations où le recours à la violence est inévitable (neutraliser celui qui tire dans une foule, par exemple), mais cela ne confère aucune légitimité à une quelconque cause : la violence en exercice ne prouve qu’elle-même, sa pure instrumentalité, son pouvoir irrépressible de détruire.
Est bien différente la position de celui qui lutte pour faire reconnaître la pleine légitimité morale et politique de son combat. Le penseur et le libérateur que fut le Mahatma Gandhi a su enseigner la profondeur éthique de la véritable aspiration à l’indépendance en comprenant la non-violence comme une force et non comme un renoncement à la force. Sa vision de la force arrête l’infinie réciprocité de la violence et de la contre-violence en ne traitant jamais la faiblesse ou la pauvreté comme un droit à la violence ; on n’a pas raison parce qu’on est faible, pauvre ou victime, mais par la souffrance que l’on est capable d’accepter pour soi-même. Le courage de laisser retomber sur soi-même les douleurs provoquées par un affrontement oppose, tant physiquement que symboliquement, la force morale et spirituelle incarnée dans la souffrance consentie à l’efficacité simplement brutale de la violence.
Alors que la violence met aux prises des volontés de puissance et de conquête, la force capable de refuser la violence s’ancre dans une loi de nature bien plus méconnue, celle de la douleur qui est universellement le propre de toute sensibilité et qui fonde la solidarité des vivants jusque dans la solidarité d’espèce (un même genre humain) de ceux qui s’affrontent à mort. « Ceux qui se soumettent volontairement à une longue suite d’épreuves grandissent en noblesse et élèvent le niveau de l’humanité entière . » Que l’action se nourrisse de choix qui ne servent pas à augmenter l’efficacité des choses, mais à exprimer la grandeur dont le genre humain est porteur échappe à l’utilitarisme, incapable de comprendre que, pour le non-violent, la force de la force est l’amour.
Mais si la non-violence radicale confine finalement à la sainteté, la responsabilité du monde, quant à elle, a besoin de force. Pour les Européens, la force de la force est la légitimité, ce qui les conduit à opposer l’éthicité de la force à la pure instrumentalité de la violence en distinguant entre le « pouvoir de » et le pouvoir sur ». Pouvoir marcher, pouvoir penser, pouvoir désirer sont des fêtes de la vie, ce sont des accomplissements, des expériences de plénitude. La virilité, quand on en fait une vertu morale, n’est pas le machisme, mais, bien au contraire, le pouvoir de refuser la violence sexuelle, et il n’est pas absurde de penser que l’idéal de la force est l’évitement de la violence. La force peut être bienveillante, ce dont la violence est incapable, sauf en se reniant. « La force crée au lieu que la violence détruit. La violence n’obtient pas la force, elle détruit celle de l’autre (et sa dignité, son estime de soi…). Mais la force de lutter contient celle de construire, de coopérer et de faire monde avec les autres. Le sentiment d’être “capable” en fait trouver en soi-même les ressources . »
Il importe au plus haut point à la politique de distinguer entre le pouvoir et la violence, autant qu’il lui est indispensable de distinguer entre l’obéissance (aux lois) et l’asservissement (aux hommes). S’il est vrai qu’« il n’y a jamais eu de gouvernement exclusivement sur l’emploi des moyens de la violence » , c’est que le pouvoir est une solidarité organisée en une capacité collective de penser et d’agir. Il manque encore à l’Europe la force de fonder un pouvoir d’agir en commun sur une solidarité culturelle qui organise son développement futur dans la vitalité de repères symboliques assurés. Il demeure que sa part de responsabilité dans le monde tel qu’il est lui enjoint de ne pas consentir à tenir une violence extrême pour une justice suprême, la faiblesse politique pour une grandeur morale et une impuissance commune pour un pacifisme concerté.
La force nous est à charge, elle n’est pas un instrument matériel dont on se servirait à son gré ; elle a besoin de solidarité, d’éthicité et même de spiritualité car elle est une figure de la culture qui retourne à la violence quand elle se « naturalise », c’est-à-dire quand elle naturalise la justice, l’honneur ou la dignité en les transformant en violences physiques déchaînées. Les Européens l’ont appris à leurs dépens dans les guerres d’un passé encore récent. Des voix avaient alors tenté de se faire entendre pour dire que « la paix est l’épanouissement de la force. La paix, la vraie paix, n’est pas un état faible où l’homme démissionne. Elle n’est pas non plus un réservoir indifférent au bon comme au pire. Elle est la force » .